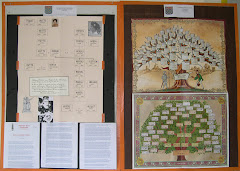Le thème du Forum des Associations de Lens 2011 était le suivant: "Selon vous, que se passerait-il si les associations s'arrêtaient demain?". Ce slogan signifait, bien sûr, la menace qui pèse sur les associations qui voient leur aide municipale de plus en plus restrainte. Une ville (ou encore d'avantage, un village, rural, notamment) sans associations, c'est une ville sans âme qui se meurt rapidement comme une ville sans commerce. Les associations, celles de Lens et celles invitées comme le Club Généalogique de l'Artois, l'ont très bien compris et se sont mobilisées pour rappeler leur raison d'être et leur volonté d'aider les populations à s'entr'aider de toutes les façons pour vivre un peu mieux, grâce aux sports, aux loisirs culturels et aux moyens sociaux et humains qu'elles peuvent mettre à lla disposition des plus défavorisés. Le CGA, quant lui, présentait à ce Forum de nombreuses généalogies rappelant les métiers anciens et les patrimoines qui étaient de véritables centres de vie, du temps de leur pleine expansion, les moulins en particulier. Les Elus Lensois et régionaux ont également apprécié la 'brève) rétrospective des géants Lensois, la plupart disparus corps et âme, ces géants qui mémorisent bien souvent la vie ancienne des villes et des citoyens qui les peuplaient.
lundi 10 octobre 2011
GENARTOIS 2011 A LIEVIN
Le 4ème trimestre 2011 a débuté à Liévin avec le Forum annuel de Généalogie et d'Histoire des Patrimoines organisé par le Club Généalogique de l'Artois au Foyer Municipal. Comme chaque année, un public modeste mais de nombreux contacts entre les participants et les passionnés de généalogie et d'histoire de nos patrimoines régionaux. Il faut dire que cette édition 2011 était particulièrement intéressante avec la présence du club Généalogie Informatique de Wallonie (Géniwal), le Comité Historique du Haut Pays (Fauquembergues-62), le Centre de Recherches Généalogiques Flandre-Artois (Bailleul-59), le Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambraisis (59), les Sources Généalogiques et Historiques des Provinces du Nord (Lille-59), et la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (Paris-75) avec son Administrateur Bernard Delrue, propriétaire du moulin de Lugy (62). Le CGA, quant à lui, était largement représenté par ses chercheurs qui ont présenté une quinzaine de généalogies sous les formes les plus diverses. La Bibliotrhèque Municipale de Liévin complétait cet éventail très attractif d'un loisir culturel qui prend de plus en plus d'ampleur au sein des populations en quête de repaires ancestraux. Place, maintenant, au VIIIème Forum qui aura lieu les 6 et 7 octobre 2012 et qui accueillera nos Amis Généalogistes de la Corrèze, entre-autres!
mardi 2 août 2011
LE COUP DE PEIGNE DU XVIIème SIECLE
Après la visite du site féodal du château d'Ivry la Bataille (27), nos reporters du CGA traversent la forêt domaniale de Dreux pour se rendre à Ezy sur Eure, aux confins de l'Ile de France et de la Normandie, entre la Perche et le Vexin, pour y découvrir le Musée du Peigne dédié à un artisanat plusieurs fois séculaire, témoin d'un patrimoine technique aujourd'hui disparu.
Installé dans une ancienne manufacture, le Musée illustre bien les techniques anciennes de créativité des femmes et des hommes de la Vallée d'Eure en y alliant celles de l'élégance et du raffinement. Il fallait pas moins de 17 opérations pour réaliser un peigne à partir de l'écaille de l'ivoire ou de la corne! Un travail d'orfèvre pour les centaines d'ouvrières et ouvriers confinés dans leurs 300 m2 d'ateliers, à Ezy et Ivry, au milieu d'un nombre invraisemblable de machines et d'outils.
Au fait, savez-vous pourquoi les peigniers choisirent Sainte Barbe comme Patronne? Et bien, nous vous l'expliquerons dans les prochains numéros de "La Vie du Club" où nous vous emmènerons à Ezy pour visiter ce musée, témoin prestigieux de l'Art et de la Haute Couture. Mais si vous passez par la Normandie, arrêtez-vous à Ezy, entre Dreux et Evreux (Musée du Peigne - Jardin de Brensbach - 2753O EZY - Email: manufacturemuseedezy@gmail.com - tél: 02.37.64.64.69).
Installé dans une ancienne manufacture, le Musée illustre bien les techniques anciennes de créativité des femmes et des hommes de la Vallée d'Eure en y alliant celles de l'élégance et du raffinement. Il fallait pas moins de 17 opérations pour réaliser un peigne à partir de l'écaille de l'ivoire ou de la corne! Un travail d'orfèvre pour les centaines d'ouvrières et ouvriers confinés dans leurs 300 m2 d'ateliers, à Ezy et Ivry, au milieu d'un nombre invraisemblable de machines et d'outils.
Au fait, savez-vous pourquoi les peigniers choisirent Sainte Barbe comme Patronne? Et bien, nous vous l'expliquerons dans les prochains numéros de "La Vie du Club" où nous vous emmènerons à Ezy pour visiter ce musée, témoin prestigieux de l'Art et de la Haute Couture. Mais si vous passez par la Normandie, arrêtez-vous à Ezy, entre Dreux et Evreux (Musée du Peigne - Jardin de Brensbach - 2753O EZY - Email: manufacturemuseedezy@gmail.com - tél: 02.37.64.64.69).
DANS LES JARDINS ENCHANTES DE MONET
Poursuivant leur périple à la découverte des patrimoines Normands, nos reporters du CGA sont allés flâner dans les allées parfumées des Jardins de Giverny, là où Claude Monet accueillait ses nombreux amis impressionnistes.
En ce dernier jour de l'exposition Bonnard (3 juillet), les visiteurs se pressent par milliers sur des files interminables pour obtenir le précieux "césame" qui leur permettra de découvrir cet univers fascinant où tant d'artistes se sont installés autour du "maître" Claude Monet.
Le silence impressionnant qui règne à l'intérieur de la maison du peintre, pourtant regorgeant de visiteurs de toutes races et de tous âges, montre bien l'admiration et le respect de chacun pour ce cadre exceptionnel où vécurent les plus grands noms de l'impressionnisme contemporain de Claude Monet, au milieu d'une incroyable galerie d'estampes Japonaises chères au maître des lieux. Le même silence accompagne la foule émerveillée dans les allées des parcs fleuris où Monet et ses amis puisaient sans doute leurs inspirations pour peindre leurs chefs d'oeuvre.
Au sortir de ces lieux enchantés, on se dirige tout naturellement vers le petit cimetière surplombant, avec l'église, le "village des peintres", l'occasion de se recueillir quelques instants devant les tombes blanches de Monet , des membres de sa famille et de ses plus proches amis, tous rassemblés dans un minuscule écrin de verdure presqu'à l'abri des regards de ces milliers de visiteurs encore sous le charme de ce paradis Normand qu'est Giverny.
Pour les généalogistes que nous sommes, citons que Claude Monet repose içi depuis le 8 décembre 1926, entouré de sa seconde épouse Alice, de ses enfants Jean Pierre, Germaine et Michel, de Gérald Van der Kemp (qui restaura la maison et les jardins de Claude Monet), du peintre Américain Théodore Earl Butler, gendre de Monet. On notera au passage que Monet eut six enfants qui ne lui laissèrent aucune descendance. Dommage...!
En ce dernier jour de l'exposition Bonnard (3 juillet), les visiteurs se pressent par milliers sur des files interminables pour obtenir le précieux "césame" qui leur permettra de découvrir cet univers fascinant où tant d'artistes se sont installés autour du "maître" Claude Monet.
Le silence impressionnant qui règne à l'intérieur de la maison du peintre, pourtant regorgeant de visiteurs de toutes races et de tous âges, montre bien l'admiration et le respect de chacun pour ce cadre exceptionnel où vécurent les plus grands noms de l'impressionnisme contemporain de Claude Monet, au milieu d'une incroyable galerie d'estampes Japonaises chères au maître des lieux. Le même silence accompagne la foule émerveillée dans les allées des parcs fleuris où Monet et ses amis puisaient sans doute leurs inspirations pour peindre leurs chefs d'oeuvre.
Au sortir de ces lieux enchantés, on se dirige tout naturellement vers le petit cimetière surplombant, avec l'église, le "village des peintres", l'occasion de se recueillir quelques instants devant les tombes blanches de Monet , des membres de sa famille et de ses plus proches amis, tous rassemblés dans un minuscule écrin de verdure presqu'à l'abri des regards de ces milliers de visiteurs encore sous le charme de ce paradis Normand qu'est Giverny.
Pour les généalogistes que nous sommes, citons que Claude Monet repose içi depuis le 8 décembre 1926, entouré de sa seconde épouse Alice, de ses enfants Jean Pierre, Germaine et Michel, de Gérald Van der Kemp (qui restaura la maison et les jardins de Claude Monet), du peintre Américain Théodore Earl Butler, gendre de Monet. On notera au passage que Monet eut six enfants qui ne lui laissèrent aucune descendance. Dommage...!
samedi 30 juillet 2011
LA CORDERIE VALLOIS DE ND DE BONDEVILLE 76
Nous sommes devant un ancien moulin à papier exploité sur les bords de la rivière du Cailly depuis 1759 et qui subit une importante mutation en 1880 pour devenir une filature en 1882. Au début des années 1820, le moulin à papier est en effet restructuré pour abriter une filature. En 1856, une machine à vapeur est installée et la filature comptera jusqu'à 5200 broches avant la "famine" cotonnière de 1859 qui lui sera fatale.
Après une reconversion en filature de laine, le moulin est loué à un cordier du Neubourg, Jules VALLOIS, qui en devient propriétaire en 1897. Il installe alors un atelier de cordes câblées au rez de chaussée et un atelier de cordes tressées au premier étage. Il emploiera jusqu'à soixante personnes avant que la Corderie ne cesse ses activités en 1978.
Construit à pan de bois sur quatre niveaux, ce bâtiment mythique n'a jamais été modifié malgré ses restructurations. Il est devenu un grand Musée Industriel de la Corderie et, mieux que tous commentaires superflus de néophytes que nous sommes , nous vous conseillons TRES VIVEMENT d'aller visiter cet extraordinaire moulin à eau et à papier d'origine et de vous extasier devant les pouvoirs non moins extraordinaires de l'eau mais aussi de l'ingéniosité des mécanismes mis en place sur ces quatre étages par les cordiers Anglais et Français qui l'équipèrent à la fin du XIXè siècle.
En tant que généalogistes, rappelons simplement que la Corderie VALLOIS est restée une petite affaire familiale jusqu'au départ de Gaston, dernier représentant de la famille du Neubourg. Il sera remplacé par un ingénieur Vosgien, Henri BRESCH, qui décèdera en 1930 et dont le gendre, Maurice MALLET, dirigera la Corderie dès 1936 jusqu'à sa fermeture en 1978. Auparavant, Jules VALLOIS, premier propriétaire des lieux, né au Neubourg (27) le 6 août 1842, avait épousé Augustine FEREL à Rouen (où ils sont décédés tous deux), qui lui donna un fils Gaston en 1877, lequel devint minotier à ND de Bondeville (alors Seine Inférieure).
Bonne visite (elle sera PASSIONNANTE, à n'en pas douter...!) à la Corderie Vallois (185 route de Dieppe 76960 ND de Bondeville - 02.35.74.35.35 - http://www.ac-rouen.fr/pedagogie).
Après une reconversion en filature de laine, le moulin est loué à un cordier du Neubourg, Jules VALLOIS, qui en devient propriétaire en 1897. Il installe alors un atelier de cordes câblées au rez de chaussée et un atelier de cordes tressées au premier étage. Il emploiera jusqu'à soixante personnes avant que la Corderie ne cesse ses activités en 1978.
Construit à pan de bois sur quatre niveaux, ce bâtiment mythique n'a jamais été modifié malgré ses restructurations. Il est devenu un grand Musée Industriel de la Corderie et, mieux que tous commentaires superflus de néophytes que nous sommes , nous vous conseillons TRES VIVEMENT d'aller visiter cet extraordinaire moulin à eau et à papier d'origine et de vous extasier devant les pouvoirs non moins extraordinaires de l'eau mais aussi de l'ingéniosité des mécanismes mis en place sur ces quatre étages par les cordiers Anglais et Français qui l'équipèrent à la fin du XIXè siècle.
En tant que généalogistes, rappelons simplement que la Corderie VALLOIS est restée une petite affaire familiale jusqu'au départ de Gaston, dernier représentant de la famille du Neubourg. Il sera remplacé par un ingénieur Vosgien, Henri BRESCH, qui décèdera en 1930 et dont le gendre, Maurice MALLET, dirigera la Corderie dès 1936 jusqu'à sa fermeture en 1978. Auparavant, Jules VALLOIS, premier propriétaire des lieux, né au Neubourg (27) le 6 août 1842, avait épousé Augustine FEREL à Rouen (où ils sont décédés tous deux), qui lui donna un fils Gaston en 1877, lequel devint minotier à ND de Bondeville (alors Seine Inférieure).
Bonne visite (elle sera PASSIONNANTE, à n'en pas douter...!) à la Corderie Vallois (185 route de Dieppe 76960 ND de Bondeville - 02.35.74.35.35 - http://www.ac-rouen.fr/pedagogie).
SAUVONS LE MOULIN DE LA PANNEVERT -Rouen 76-
Avec le four banal, reconstitué sur l'autre rive, le Moulin de la Pannevert fait partie d'un ensemble bucolique bordant le Robec, dans les faubourg est de Rouen. Son origine serait un hameau de verdure sur le route des petites eaux du Robec aux environs de 1199. Le lit du Robec , appelé plancher, était alors pavé de pierres avec des mesures précises destinées à règlementer l'entrée de la dépense, des deux vidanges, de la postille entre les deux vidanges, de la pente du train de l'eau, du seuil gravier, du tréteau portant l'arbre de la roue à aubes et de l'arrière-fosse. La succession des moulins sur le Robec obligeait cette règlementation pour ceux qui accaparaient trop d'énergie (il y a eu jusqu'à 45 usines sur le Robec!). Depuis 1868, l'eau est captée directement à la source du Robec.
A l'origine, on trouve un premier bâtiment en pan de bois construit sur la rive et servant de mur de tampanne à la roue. Un second bâtiment est venu s'accoler au premier vers le XVIIIè. La roue était en bois et les vannes mues à l'aide de leviers de bois. Les installations hydrauliques comportaient trois vannes: la vanne motrice pour évacuer le débit de l'eau; la vanne de chômage, et la vanne d'avarie pour évacuer l'excés d'eau ou faciliter les travaux d'entretien des installations.
Le moulin n'a jamais été équipé de déversoir pourtant règlementaire. Depuis 1880, le vannage est effectué mécaniquement. A l'intérieur du moulin, on peut encore admirer l'impressionnante mécanique destinée à transmettre les mouvements aux meules encore en place à l'étage. Une grande opération de sauvetage de l'ensemble du moulin est lancée par l'Association de Sauvegarde du Moulin de la Pannevert (dont le CGA est membre bienfaiteur). Il suffit de contacter l'ASM de la Pannevert (02.35.98.25.17) à Rouen 76. (site internet: moulindepannevert.over-blog.com). A noter que l'ASM est, elle-même, membre du CGA.
A l'origine, on trouve un premier bâtiment en pan de bois construit sur la rive et servant de mur de tampanne à la roue. Un second bâtiment est venu s'accoler au premier vers le XVIIIè. La roue était en bois et les vannes mues à l'aide de leviers de bois. Les installations hydrauliques comportaient trois vannes: la vanne motrice pour évacuer le débit de l'eau; la vanne de chômage, et la vanne d'avarie pour évacuer l'excés d'eau ou faciliter les travaux d'entretien des installations.
Le moulin n'a jamais été équipé de déversoir pourtant règlementaire. Depuis 1880, le vannage est effectué mécaniquement. A l'intérieur du moulin, on peut encore admirer l'impressionnante mécanique destinée à transmettre les mouvements aux meules encore en place à l'étage. Une grande opération de sauvetage de l'ensemble du moulin est lancée par l'Association de Sauvegarde du Moulin de la Pannevert (dont le CGA est membre bienfaiteur). Il suffit de contacter l'ASM de la Pannevert (02.35.98.25.17) à Rouen 76. (site internet: moulindepannevert.over-blog.com). A noter que l'ASM est, elle-même, membre du CGA.
Le CGA visite les patrimoines.Le moulin de l'Arbalète, de St Maclou -76-
Le CGA a profité des vacances de ses représentants en Normandie pour visiter quelques moulins notoires. En tant que membre de la FMF et de la FFAM, le club y a reçu un excellent accueil et voulait en remercier leurs propriétaires, privés ou associatifs, en réalisant, pour chacun, un blog que vous pouvez diffuser à tous vos amis!
La première visite fut pour le Moulin de l'Arbalète, moulin à eau situé sur le lit du plus petit fleuve de France, la Scie,construit près de l'abbaye de St Victor en Caux par Hugues de Mortemer. Avant 1801, le moulin recevait l'eau sous la roue à aubes; depuis cette date, la nouvelle roue reçoit l'eau par dessus.
Non loin, il y avait un autre moulin, celui de "La Pierre", un moulin à trèfle pour les agriculteurs, appartenant à Alfred Lefebvre, minotier-grainetier, surnommé "Clémenceau". En 1924, "Clémenceau" achète le moulin de l'Arbalète devenu le seul du secteur. Il faut noter que pendant la Première Guerre 14/18, les Allemands avaient réquisitionné le moulin de La Pierre pour y héberger leurs prisonniers de guerre et l'avaient ensuite abandonné...La Seconde Guerre Mondiale allait provoquer le bombardement de la voie ferrée qui desservait le moulin de l'Arbalète et les maisons à colombages qui formaient le hameau de St Maclou. Alfred "Clémenceau" et sa femme se réfugièrent alors dans le moulin et permirent ainsi la reprise des ses activités de mouture et de graineterie. "Clémenceau" mourrut le 29.06.1957 et son épouse en 1963. Leur fille Janine s'était mariée en 1953 avec le meunier actuel Henri TACCOEN (celui qui nous a si gentiment reçus!) mais elle mourra très vite, le 30.11.1966 et Henri va poursuivre, seul, le travail au moulin.
En 1994, le mécanisme du moulin est entièrement restauré . Entre temps, notre érudit meunier Henri va dénicher un bois précieux et une seconde paire de meules, en Saône et Loire près de Macon, pour le mouturage de céréales, ce qui lui permettra de cuire du pain à l'ancienne avec l'aide des membres de l'Association qui s'est créée en 1994 et de sa seconde épouse Marguerite.
Longue vie au "Centre Culturel et Touristique de l'Arbalète" (02.35.32.67.11) à St Maclou de Folleville 76890 (http://moulinarbalete.free.fr/).
La première visite fut pour le Moulin de l'Arbalète, moulin à eau situé sur le lit du plus petit fleuve de France, la Scie,construit près de l'abbaye de St Victor en Caux par Hugues de Mortemer. Avant 1801, le moulin recevait l'eau sous la roue à aubes; depuis cette date, la nouvelle roue reçoit l'eau par dessus.
Non loin, il y avait un autre moulin, celui de "La Pierre", un moulin à trèfle pour les agriculteurs, appartenant à Alfred Lefebvre, minotier-grainetier, surnommé "Clémenceau". En 1924, "Clémenceau" achète le moulin de l'Arbalète devenu le seul du secteur. Il faut noter que pendant la Première Guerre 14/18, les Allemands avaient réquisitionné le moulin de La Pierre pour y héberger leurs prisonniers de guerre et l'avaient ensuite abandonné...La Seconde Guerre Mondiale allait provoquer le bombardement de la voie ferrée qui desservait le moulin de l'Arbalète et les maisons à colombages qui formaient le hameau de St Maclou. Alfred "Clémenceau" et sa femme se réfugièrent alors dans le moulin et permirent ainsi la reprise des ses activités de mouture et de graineterie. "Clémenceau" mourrut le 29.06.1957 et son épouse en 1963. Leur fille Janine s'était mariée en 1953 avec le meunier actuel Henri TACCOEN (celui qui nous a si gentiment reçus!) mais elle mourra très vite, le 30.11.1966 et Henri va poursuivre, seul, le travail au moulin.
En 1994, le mécanisme du moulin est entièrement restauré . Entre temps, notre érudit meunier Henri va dénicher un bois précieux et une seconde paire de meules, en Saône et Loire près de Macon, pour le mouturage de céréales, ce qui lui permettra de cuire du pain à l'ancienne avec l'aide des membres de l'Association qui s'est créée en 1994 et de sa seconde épouse Marguerite.
Longue vie au "Centre Culturel et Touristique de l'Arbalète" (02.35.32.67.11) à St Maclou de Folleville 76890 (http://moulinarbalete.free.fr/).
Inscription à :
Articles (Atom)